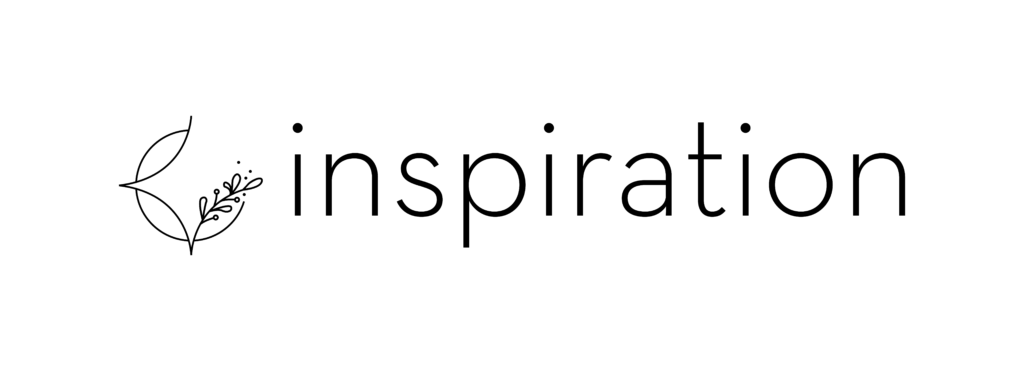La salle de bain est aujourd’hui une pièce cruciale dans nos habitations. Espace de détente, dédié au bien-être et au confort, décoré avec soin, la salle de bain représente plus qu’un simple lieu d’hygiène. Mais en a t’il toujours été ainsi ? Découvrons l’évolution de cette pièce au cours des âges…
L’Antiquité : les origines.
Nous savons que les anciens Egyptiens avaient comme tradition de prendre régulièrement soin de leur corps et étaient connus pour leur amour de la propreté. En effet, l’eau était perçue comme une ressource précieuse et considérée comme un élément purificateur pour le corps et l’âme, ce qui leur permettait de se rapprocher des Dieux. Ils se lavaient donc plusieurs fois par jour. Les anciens Egyptiens étaient connus par ailleurs pour leur utilisation de produits cosmétiques.
Les romains étaient également friands de bains et de l’eau en général. En effet, que cela soit les anciens Grecs ou les anciens Romains, ils savaient parfaitement que la propreté était la clé de la santé. D’ailleurs, tant les riches notables que les gens du peuple avaient pour tradition d’aller régulièrement aux thermes publics. C’étaient un moyen pour eux d’établir des relations sociales.
Les thermes à cette époque étaient composés de plusieurs bâtiments, où se trouvaient une piscine, des vestiaires, des terrains de sport, un sauna… Les thermes de Stabies, découverts à Pompéi (2ème siècle avant J.C.), comptent parmi les plus célèbres.
Les civilisations grecques, romaines et égyptiennes ont donc popularisé les thermes, les bains publics et les étuves, mais les plus riches avaient déjà leur propre salle de bain privée. Par exemple, les villas romaines étaient connues pour leur système hydraulique sophistiqué, comprenant l’eau courante, chaude et froide… Les salles de bain avaient des lavabos, des robinets et des baignoires et tout un système de tuyauterie en plomb et en terre cuite.


La période du Moyen-Age : un changement profond des mœurs.
A la fin de l’Antiquité, les choses comment à changer. Les bains privés dans les demeures se raréfient, quelques étuves publiques subsistent à Paris et dans les grandes villes, mais les hommes et les femmes les fréquentent de moins en moins. Contrairement aux riches, les gens de la campagne se lavaient plus, car ils voulaient enlever la sueur qu’ils avaient sur eux après le travail. Paradoxalement, les pauvres étaient ceux qui étaient les plus propres à cette époque là !
Mais le rapport à l’hygiène et au corps se détériore considérablement au fil du Moyen-Age. La vision chrétienne qui s’impose de plus en plus a fortement influencé cet état, en considérant le fait de se baigner comme étant un péché et une débauche ! C’est pour cette raison que dans les monastères, les moines ne se lavaient que quelques fois par an.
Mais cela s’accentue encore plus au XIV ème siècle lorsque l’épidémie de la peste ravage l’Europe. Les gens à cette époque avaient totalement cessé de veiller à leur hygiène et étaient persuadés que les pores ouverts facilitaient l’entrée de la maladie dans le corps. Ils pensaient alors qu’une épaisse couche de saletés allaient les protéger…
L’eau était toujours considérée comme mauvaise, même dans les hautes sphères, qui privilégiaient la toilette sèche, en utilisant des accessoires en ivoire pour se gratter et en masquant leur mauvaise odeur corporelle à l’aide de poudres et de parfums.
La toilette sèche perdure encore longtemps. On dit qu’à la cour royale, au XVII ème siècle, le roi Louis XIV ne s’est baigné que deux fois… dans sa vie ! À Versailles, la propreté revient à se parfumer pour camoufler les odeurs et porter des vêtements propres. Pour cela, on se change plusieurs fois par jour, ce que le peuple ne peut se permettre de faire, et qu’on considère par conséquent comme sale.
Fin XVII et XVIII ème siècle : transition entre la toilette sèche et humide.
A cette époque, l’hygiène prend une autre dimension. On reprend l’habitude de se laver à l’eau. Et les plus riches assurent maintenant aux plus pauvres que la propreté rend « résistant ». Evidemment, seuls les privilégiés pouvaient se payer le luxe d’avoir une salle de bain et l’eau chauffée. Pour les moins riches, qui ne pouvaient pas avoir de salle de bain, il existait un baigneur qui venait avec sa citerne d’eau chaude et s’installait dans les maisons pour les laver. Et pour les plus pauvres, ils allaient se laver dans les ruisseaux ou les égouts.
Dès le début du XVII ème siècle, on commence à industrialiser la fabrication du savon, notamment à Marseille, à partir des matières premières issues des colonies. Mais il faut attendre la fin du XVIII ème et le début du XIX ème siècle, pour que l’idée d’hygiène telle qu’on l’entend aujourd’hui commence à faire son chemin.
“VOIR UNE DAME À SA TOILETTE, L’ENTRETENIR À SA TOILETTE, SIGNIFIE LA VOIR, L’ENTRETENIR PENDANT QU’ELLE S’HABILLE”
(Définition, sens du mot « toilette » donné par le dictionnaire de l’Académie française de 1762)
A partir du XIX ème siècle : le retour complet de l’hygiène.
C’est ainsi que les découvertes scientifiques au XIX ème siècle, dont celles de Pasteur sur les microbes, vont finir par tout changer. L’hygiène devient une obsession et est enseignée et pratiquée à la maison comme à l’école.
La révolution industrielle facilite également l’accès aux produits d’hygiène (savons, lotions, poudres, eaux de Cologne…) et permet des progrès immenses en matière de santé publique. Les habitations, comme les appartements bourgeois et ceux de la classe moyenne, s’équipent progressivement en salles d’eau.
Après-guerre, les appartements équipés de salles de bains modernes se généralisent en ville.
Aujourd’hui, nous prenons plaisir d’avoir une belle salle de bains, tout confort, voire plusieurs dans une même habitation. La nouveauté à notre époque repose principalement sur la domotique et les nouvelles technologies, qui font entrer la salle de bain dans une nouvelle ère de la connexion (réglage du chauffage à distance, choix précis de la température de l’eau, variateurs lumineux…).

Tendances déco des salles de bain en 2024.
La salle de bain est une des pièces où le coût de la rénovation au mètre carré est le plus élevé. Il est donc primordial qu’elle reflète la personnalité de ses habitants et s’adapte à leur mode de vie. Pour cela, l’esthétisme, le confort et la praticité sont aux premières loges. Si on devait résumer la salle de bain idéale en 2024, on la décrirait ainsi : lumineuse, saine, agréable, confortable et la plus réconfortante possible.
Pour répondre à ces besoins, les formes organiques sont idéales pour intégrer de la douceur dans la pièce (formes rondes et enveloppantes).
Quant aux matériaux naturels (bois, céramique, pierre, terre cuite comme le zellige), ils permettent de se reconnecter à la nature. Par exemple, les façades avec des décors bois en relief 3D connaissent un engouement remarquable.
Et pour finir, pour apporter une touche de luxe, le laiton sera qualifié, que ce soit pour la robinetterie, les miroirs ou les luminaires. En effet, le laiton a une apparence élégante et intemporelle qui s’harmonise avec n’importe quel style de décoration.
En ce qui concerne les effets et les couleurs, bien que le mat et le brillant cohabitent toujours, la matité prend de plus en plus d’importance, principalement le blanc et le noir.
Les couleurs pastel et lumineuses dominent cependant la salle de bain de 2024. Le bleu, le vert tendre, ou encore les couleurs chaudes avec le rose et les teintes orangées sont aux premières loges.
Si on parle de styles, alors le style japandi et les ambiances contemporaines épurées sont recherchés. Ils permettent en effet d’agrandir la pièce, et d’obtenir une atmosphère calme et reposante, propice à la détente et à la relaxation.
Se réaliser soi commence
par son intérieur.

Je suis Sophie Piranda, créatrice d’Inspiration. L’accompagnement que je vous propose en psychologie de l’habitat, permet d’associer votre bien-être personnel à la création d’espaces et d‘élégances qui font sens. Je prends le temps d’observer votre quotidien et vos habitudes, afin de vous proposer des solutions concrètes, inspirées et efficaces pour alléger et harmoniser durablement votre intérieur.
QUIZZ : « Quelle est la différence entre salle de bain et salle d’eau ? »
Une salle d’eau est une pièce où vous trouverez un lavabo et une douche.
La salle de bain quant à elle sera dénommée ainsi, si elle comporte au moins un lavabo et… une baignoire (pour se baigner) !